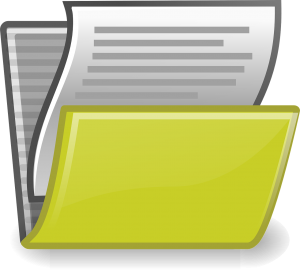«Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives – Contrat d’assurance – Article 4, paragraphe 2 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat – Clause visant à garantir la prise en charge des échéances d’un contrat de prêt immobilier – Incapacité totale de travail de l’emprunteur – Exclusion du bénéfice de cette garantie en cas d’aptitude reconnue à exercer une activité rémunérée ou non»
Dans l’affaire C‑96/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de grande instance de Nîmes (France), par décision du 26 février 2014, parvenue à la Cour le 28 février 2014, dans la procédure
Jean-Claude Van Hove
contre
CNP Assurances SA,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2014,
considérant les observations présentées:
– pour CNP Assurances SA, par Mes P. Woolfson et I. de Seze, avocats,
– pour le gouvernement français, par MM. S. Menez et D. Colas ainsi que par Mme S. Ghiandoni, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme M. Owsiany-Hornung et M. M. van Beek, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Van Hove à CNP Assurances SA (ci-après «CNP Assurances») au sujet du caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle incluse dans un contrat d’assurance comportant la définition de l’incapacité totale de travail au titre de la prise en charge par cette société des échéances des prêts immobiliers souscrits par M. Van Hove.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les dix-neuvième et vingtième considérants de la directive 93/13 sont libellés comme suit:
«considérant que, pour les besoins de la présente directive, l’appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur des clauses décrivant l’objet principal du contrat ou le rapport qualité/prix de la fourniture ou de la prestation; que l’objet principal du contrat et le rapport qualité/prix peuvent, néanmoins, être pris en compte dans l’appréciation du caractère abusif d’autres clauses; qu’il en découle, entre autres, que, dans le cas de contrats d’assurance, les clauses qui définissent ou délimitent clairement le risque assuré et l’engagement de l’assureur ne font pas l’objet d’une telle appréciation dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur;
considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles; que le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, doit prévaloir l’interprétation la plus favorable au consommateur».
4 L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive prévoit:
«La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.»
5 L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive dispose:
«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»
6 L’article 4 de la directive 93/13 énonce:
«1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.»
7 Aux termes de l’article 5 de cette directive:
«Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. […]»
Le droit français
8 L’article L. 132-1, septième alinéa, du code de la consommation, qui transpose en droit français l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, dispose:
«L’appréciation du caractère abusif des clauses […] ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.»
9 L’article L. 133-2 de ce code est ainsi rédigé:
«Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. […]»
Le litige au principal et la question préjudicielle
10 Au cours du mois de juillet 1998, M. Van Hove a conclu avec le Crédit Immobilier de France Méditerranée deux contrats de prêt d’un montant, respectivement, de 340 600 francs français (FRF) (51 924 euros) et de 106 556 FRF (16 244 euros), remboursables par mensualités de 434,43 euros jusqu’au 31 mars 2016, pour l’un, et de 26,70 euros jusqu’au 31 mars 2017, pour l’autre.
11 Lors de la conclusion de ces contrats de prêt, il a adhéré à un «contrat d’assurance groupe» de CNP Assurances (ci-après le «contrat d’assurance»). La première clause de ce contrat d’assurance garantit la prise en charge des échéances «dues par les emprunteurs à la contractante, en cas de décès, d’invalidité permanente et absolue, ou 75 % des échéances pour l’incapacité totale de travail».
12 En vertu de la deuxième clause dudit contrat, «(l)’assuré est en état d’incapacité totale de travail lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours (dite délai de carence), il se trouve dans l’impossibilité de reprendre une quelconque activité rémunérée ou non à la suite d’un accident ou d’une maladie».
13 Le 17 février 2010, M. Van Hove a été placé en arrêt de travail en raison d’une rechute liée à un accident de travail datant du 13 juin 2000. Son état de santé a été consolidé le 17 octobre 2005. L’incapacité permanente partielle de travail dont il est atteint avait, quant à elle, été évaluée à 23 %.
14 Le 14 mai 2005, il avait été opéré d’une fistule, retenue au titre de l’accident du travail. La date de consolidation de son état de santé avait été fixée au 4 novembre 2005 et son incapacité permanente partielle de travail avait été estimée à 67 %. Un nouvel arrêt de travail avait été prescrit le 3 août 2007, en raison d’une recrudescence des vertiges, et avait été prolongé jusqu’au 22 février 2008.
15 À compter du 1er janvier 2011, l’incapacité permanente partielle de travail dont il est atteint a été fixée par la sécurité sociale à 72 %. À ce titre, une rente mensuelle de 1 057,65 euros lui a été allouée.
16 Le 18 juin 2012, afin de déterminer les garanties dues par CNP Assurances, le médecin mandaté par celle-ci a procédé à l’examen de M. Van Hove. Il en a conclu que l’état de santé de ce dernier lui permettait d’exercer une activité professionnelle adaptée à temps partiel. Par un courrier du 10 juillet 2012, CNP Assurances a notifié à M. Van Hove que, à compter du 18 juin 2012, elle ne prendra plus en charge les échéances de ses prêts. Par un nouveau courrier du 29 août 2012, elle a maintenu son refus de remboursement, lui précisant que si son état de santé n’était plus compatible avec la reprise de sa profession antérieure, il disposait de la faculté d’exercer une activité professionnelle adaptée, du moins à temps partiel.
17 Le 4 mars 2013, M. Van Hove a assigné CNP Assurances devant la juridiction de renvoi. Il demande, à titre principal, sur le fondement notamment des dispositions du code de la consommation, que les clauses du contrat le liant à CNP Assurances, concernant la définition de l’incapacité totale de travail et les conditions dans lesquelles la garantie est acquise, soient déclarées abusives et de condamner la partie défenderesse au principal à prendre en charge les sommes restant dues au titre des deux prêts susvisés à compter du mois de juin 2012.
18 Au soutien de ses demandes, M. Van Hove fait, d’une part, valoir que la clause du contrat d’assurance, qui subordonne la prise en charge par l’assureur à l’impossibilité absolue de reprendre une activité quelconque rémunérée ou non, est abusive parce qu’elle crée entre les parties un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. D’autre part, il soutient que la définition de l’incapacité totale de travail est rédigée de telle manière qu’elle ne permet pas à un consommateur profane d’en comprendre la portée.
19 CNP Assurances demande, en substance, à la juridiction de renvoi de débouter M. Van Hove de sa demande de prise en charge. En effet, la définition de l’incapacité totale de travail, au sens de ce contrat, subordonnerait, d’une part, dans des termes clairs et précis, la prise en charge à la condition que l’intéressé soit dans l’incapacité totale de travailler. Or, elle fait valoir que, depuis le 18 juin 2012, M. Van Hove n’est plus dans une situation d’incapacité totale de travail, au sens dudit contrat, car le médecin expert qu’elle a mandaté a estimé qu’il était apte à exercer une activité professionnelle adaptée et a fixé son taux d’incapacité fonctionnelle à 20 %. Elle précise à cet égard que les critères pris en compte pour fixer ce taux sont différents de ceux retenus par la sécurité sociale. D’autre part, ladite clause ne saurait constituer une clause abusive, parce qu’elle porte sur l’objet même du contrat et qu’elle ne créerait pas un déséquilibre significatif au détriment du requérant, dans la mesure où celui-ci a bénéficié de la prise en charge de ses échéances pendant plus de deux ans.
20 La juridiction de renvoi souligne que la solution du litige dont elle est saisie commande de statuer sur le point de savoir si la deuxième clause du contrat d’assurance constitue ou non une clause abusive.
21 Cette juridiction précise que la Cour de cassation a, par un arrêt récent, jugé que la clause relative à la garantie de l’incapacité temporaire totale de travail, qui prévoit que les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle l’état de santé de l’assuré ne lui permet, temporairement, d’effectuer aucune activité professionnelle et qui précise que ces indemnités lui sont versées jusqu’à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, définit l’objet principal du contrat et relève de l’article L. 132-1, septième alinéa, du code de la consommation. Ainsi, le tribunal de grande instance de Nîmes estime que, eu égard à cet arrêt, la clause en cause dans l’affaire pendante devant lui pourrait, en vertu de cette disposition, être exclue du champ d’application de la notion de «clause abusive».
22 Par ailleurs, si cette juridiction constate que, contrairement à ce que soutient M. Van Hove, les termes de cette clause, selon laquelle la prise en charge de l’incapacité totale de travail est subordonnée à la condition que l’assuré se trouve dans l’«impossibilité de reprendre une quelconque activité rémunérée ou non à la suite d’un accident ou d’une maladie», sont clairs et précis, elle fait néanmoins observer qu’il n’est pas exclu que ladite clause relève de la notion de «clause abusive», au sens de la directive 93/13.
23 En effet, cette même juridiction considère que cette clause, en définissant la notion d’«incapacité totale de travail», détermine les conditions requises afin de bénéficier de la garantie d’assurance. Cependant, ladite clause exclut du bénéfice de cette garantie l’assuré qui est reconnu apte à exercer une activité professionnelle quelconque, même non rémunérée. Or, selon ladite juridiction, la finalité d’une police d’assurance, telle que celle en cause dans le litige qui lui est soumis, est de garantir la bonne exécution des engagements souscrits par l’emprunteur dans l’hypothèse où l’état de santé de ce dernier ne lui permettrait plus d’exercer une activité lui procurant les revenus nécessaires afin de faire face à ses engagements.
24 En ce que ladite clause aurait pour effet d’exclure l’emprunteur du bénéfice de la garantie en cas d’incapacité totale de travail, dès lors qu’il est déclaré apte à exercer une activité professionnelle, même lorsque celle-ci n’est pas susceptible de lui procurer le moindre revenu, elle priverait la police d’assurance d’une partie de son objet. La juridiction de renvoi considère, par conséquent, que la deuxième clause du contrat d’assurance pourrait être analysée comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur.
25 C’est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Nîmes a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 4, paragraphe 2, de la directive [93/13] doit-il être interprété en ce sens que la notion de clause portant sur la définition de l’objet principal du contrat, visée à cette disposition, recouvre une clause stipulée dans un contrat d’assurance visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur, qui exclut l’assuré du bénéfice de cette garantie s’il est déclaré apte à exercer une activité non rémunérée?»
Sur la question préjudicielle
26 À titre liminaire, il convient de rappeler, d’une part, que, selon une jurisprudence constante, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (voir, notamment, arrêt Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 48 et jurisprudence citée).
27 D’autre part, eu égard à une telle situation d’infériorité, la directive 93/13 oblige les États membres à prévoir un mécanisme assurant que toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle puisse être contrôlée afin d’apprécier son caractère éventuellement abusif. Ainsi, il incombe au juge national de déterminer, en tenant compte des critères énoncés aux articles 3, paragraphe 1, et 5 de la directive 93/13, si, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, une telle clause satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par cette directive (voir arrêt Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 40 et jurisprudence citée).
28 De la même manière, s’il incombe à la seule juridiction de renvoi de se prononcer sur la qualification de ces clauses en fonction des circonstances propres au cas d’espèce, il n’en demeure pas moins que la Cour est compétente pour dégager des dispositions de la directive 93/13, en l’occurrence celles de l’article 4, paragraphe 2, de celle-ci, les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen de clauses contractuelles au regard de celles-ci (arrêt Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 45).
29 Par sa question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause stipulée dans un contrat d’assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur, qui exclut cet assuré du bénéfice de ladite garantie s’il est déclaré apte à exercer une activité rémunérée ou non, relève de l’exception énoncée à cette disposition.
30 Il ressort de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
31 La Cour a déjà jugé que cette disposition édictant une exception au mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives, tel que prévu par le système de protection des consommateurs mis en œuvre par la directive 93/13, il convient de lui donner une interprétation stricte (voir arrêts Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 42, ainsi que Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, point 49).
32 C’est dans ce cadre qu’il convient d’examiner la question posée par la juridiction de renvoi. Afin de répondre à cette question, il y a lieu d’examiner, d’une part, si une clause, telle que celle en cause au principal, relève de l’objet principal d’un contrat d’assurance et, d’autre part, si une telle clause est rédigée de façon claire et compréhensible.
Sur la notion d’«objet principal du contrat»
33 Les clauses du contrat qui relèvent de la notion d’«objet principal du contrat», au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci (voir, en ce sens, arrêts Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C‑484/08, EU:C:2010:309, point 34, ainsi que Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 49). En revanche, les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel ne sauraient relever de la notion d’«objet principal de contrat», au sens de cette disposition (arrêts Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 50, ainsi que Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, point 54).
34 En ce qui concerne le point de savoir si une clause relève de l’objet principal d’un contrat d’assurance, il importe de relever, d’une part, que, selon la jurisprudence de la Cour, une opération d’assurance se caractérise par le fait que l’assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à l’assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat (arrêts CPP, C‑349/96, EU:C:1999:93, point 17; Skandia, C‑240/99, EU:C:2001:140, point 37, et Commission/Grèce, C‑13/06, EU:C:2006:765, point 10).
35 D’autre part, s’agissant d’une clause contractuelle contenue dans un contrat d’assurance conclu entre un professionnel et un consommateur, le dix-neuvième considérant de la directive 93/13 dispose que, dans de tels contrats, les clauses définissant ou délimitant clairement le risque assuré et l’engagement de l’assureur ne font pas l’objet d’une appréciation du caractère abusif, dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur.
36 En l’occurrence, la juridiction de renvoi précise que la clause contractuelle en cause comporte la définition de la notion d’«incapacité totale de travail» et détermine les conditions requises pour qu’un emprunteur puisse bénéficier de la garantie du paiement des sommes dues par ce dernier dans le contexte de son prêt. Dans ces circonstances, il ne saurait être exclu qu’une telle clause délimite le risque assuré ainsi que l’engagement de l’assureur et fixe la prestation essentielle du contrat d’assurance en cause, ce qu’il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.
37 À cet égard, la Cour a eu l’occasion de rappeler que l’examen d’une clause contractuelle, afin de déterminer si celle-ci relève de la notion d’«objet principal du contrat», au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, doit être effectué au regard de la nature, de l’économie générale et de l’ensemble des stipulations du contrat ainsi que de son contexte juridique et factuelle (voir, en ce sens, arrêt Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, points 50 ainsi que 51).
38 Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de déterminer dans quelle mesure, eu égard à ces éléments, la clause en cause dans le litige pendant devant elle fixe un élément essentiel de l’ensemble contractuel dans lequel elle s’inscrit, qui, comme tel, caractérise cet ensemble.
39 Si la juridiction de renvoi devait conclure que celle-ci fait partie de l’objet principal de cet ensemble contractuel, cette juridiction devra également vérifier que ladite clause est rédigée par le professionnel de façon claire et compréhensible (voir, en ce sens, arrêt Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C‑484/08, EU:C:2010:309, point 32, ainsi que ordonnance Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, point 72).
Sur la notion de «rédaction claire et compréhensible»
40 La Cour a eu l’occasion de préciser que l’exigence de transparence des clauses contractuelles, posée par la directive 93/13, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci. Au contraire, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de transparence doit être entendue de manière extensive (voir, en ce sens, arrêts Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, points 71 et 72, ainsi que Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, point 73).
41 Revêtent ainsi pour le consommateur une importance essentielle aux fins du respect de l’exigence de transparence non seulement l’information donnée préalablement à la conclusion du contrat sur les conditions de l’engagement, mais également l’exposé des particularités du mécanisme de prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. Il en va ainsi dans la mesure où le consommateur décidera, au regard de ces deux types d’éléments, s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel en adhérant aux conditions rédigées préalablement par celui-ci (voir, par analogie, arrêts RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, point 44; Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, points 70 et 73, ainsi que Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, point 74).
42 En l’occurrence, si la juridiction de renvoi considère que les termes de la clause en cause au principal sont clairs et précis, elle relève simultanément que l’expression «reprendre une quelconque activité rémunérée ou non», figurant à cette clause, peut être comprise de différentes manières. Outre l’interprétation suggérée par CNP Assurances, selon laquelle cette expression permet également aux assurés qui n’exercent pas une activité rémunérée au moment d’un accident ou d’une maladie d’être considérés comme étant en état d’incapacité totale de travail, il n’est pas à exclure, comme cela est exposé au point 24 du présent arrêt et comme l’ont fait observer le gouvernement français ainsi que la Commission européenne lors de l’audience, que ladite expression puisse être interprétée en ce sens qu’elle ne permet pas à une personne, pouvant exercer une activité quelconque, de bénéficier de la prise en charge des échéances qu’elle doit à son cocontractant au titre de la garantie invalidité.
43 À l’instar de la Commission, il y a lieu de relever qu’il ne saurait être exclu, en l’occurrence, que, même si la clause est rédigée de manière grammaticalement correcte, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier, la portée de cette clause n’a pas été comprise par le consommateur.
44 En effet, cette institution relève que le contrat d’assurance a été conclu afin de protéger le consommateur des conséquences qui résulteraient de son impossibilité de faire face aux mensualités de ses prêts. De la sorte, ce dernier pouvait s’attendre à ce que la notion d’«activité rémunérée ou non», figurant dans le contrat d’assurance et incluse dans la définition de l’incapacité totale de travail, corresponde à une activité professionnelle pouvant, au moins potentiellement, faire l’objet d’une rémunération suffisante afin qu’il puisse honorer les échéances mensuelle de ses emprunts.
45 Ainsi qu’il résulte des débats lors de l’audience, les doutes relatifs à l’absence de clarté de la clause en cause au principal sont renforcés par le caractère extrêmement large et vague de l’expression «activité rémunérée ou non» employée à celle-ci. En effet, le terme d’activité, comme le souligne la Commission, peut englober toute opération ou activité humaine réalisée afin d’arriver à une fin précise.
46 En l’espèce, ainsi que le relève le gouvernement français dans ses observations écrites, le consommateur n’a pas nécessairement pris conscience, au moment de la conclusion du contrat en cause au principal, de la circonstance que la notion d’«incapacité totale de travail», au sens de celui-ci, ne correspondait pas à celle d’«incapacité permanente partielle», au sens du droit français de la sécurité sociale.
47 Dès lors, s’agissant des particularités d’une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, il appartient au juge de renvoi de déterminer si, au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents, dont la publicité et l’information fournies par l’assureur dans le cadre de la négociation du contrat d’assurance ainsi que, plus généralement, de l’ensemble contractuel, un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pouvait non seulement connaître l’existence de la différence entre la notion d’«incapacité totale de travail», au sens du contrat en cause au principal, et celle d’«incapacité permanente partielle», au sens du droit national de la sécurité sociale, mais également évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives pour lui, de la limitation de la garantie incluse dans la police d’assurance conformément aux exigences découlant de la jurisprudence rappelée au point 41 du présent arrêt.
48 Pourrait être également pertinente dans ce contexte la circonstance que le contrat en cause au principal se situe dans un ensemble contractuel plus vaste et est lié aux contrats de prêt. En effet, il ne saurait être exigé du consommateur, lors de la conclusion de contrats liés, la même vigilance quant à l’étendue des risques couverts par ce contrat d’assurance que s’il avait conclu de manière distincte ledit contrat et les contrats de prêt.
49 Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi arrivait à la conclusion qu’une clause, telle que celle en cause au principal, ne relève pas de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 5 de cette directive, si le libellé d’une clause contractuelle n’est pas clair, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.
50 Il convient, dès lors, de répondre à la question posée que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause stipulée dans un contrat d’assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur ne relève de l’exception figurant à cette disposition que pour autant que la juridiction de renvoi constate:
– d’une part, que, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations de l’ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci et
– d’autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c’est-à-dire qu’elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
Sur les dépens
51 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause stipulée dans un contrat d’assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur ne relève de l’exception figurant à cette disposition que pour autant que la juridiction de renvoi constate:
– d’une part, que, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations de l’ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci et
– d’autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c’est-à-dire qu’elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
Signatures
[collapse]
 Le Conseil d’Etat a été amené, dans une décision du 17 juin 2015 (requête n° 385924), à rappeler que le secret médical père sur le médecin en toute circonstance
Le Conseil d’Etat a été amené, dans une décision du 17 juin 2015 (requête n° 385924), à rappeler que le secret médical père sur le médecin en toute circonstance