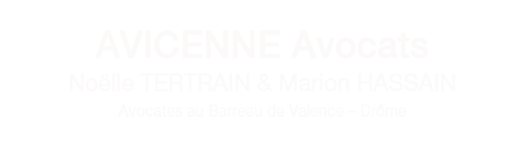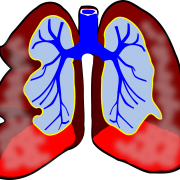Frais de logement adaptés
Frais de logement adaptés
Il appartient aux juges du fond d’examiner, dans leur appréciation souveraine, les éléments de preuve produits par la victime pour en déduire que les frais d’acquisition et d’aménagements de la maison exposés par elle étaient en relation directe avec l’accident et devaient être pris en charge en totalité par le responsable, indépendamment de l’économie réalisée par le non-paiement d’un loyer et de la réalisation d’un placement immobilier.
Dans le cas d’espèce soumis à la Cour de cassation, l’appartement loué par la victime après son accident n’était pas adapté à son handicap.
Le caractère provisoire d’une location ne permettait pas de faire les aménagements nécessaires.
Aussi avait-elle dû acquérir un terrain et à y faire construire une maison comportant des aménagements motivés par ses séquelles physiques. Pour les juges, les factures concernant la maison étaient toutes justifiées par le handicap de la victime.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 février 2015
N° de pourvoi: 14-16015
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
Mme Flise (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été victime en 2011 d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par M. Y… ; qu’à la suite de l’annulation du contrat d’assurance liant celui-ci à son assureur, Mme X… a fait assigner en indemnisation de ses préjudices M. Y…, en présence du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le FGAO fait grief à l’arrêt d’allouer à Mme X… une certaine somme au titre des frais de logement adapté, alors, selon le moyen, que l’indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que le préjudice lié aux frais de logement adapté, correspondant aux dépenses que la victime handicapée doit exposer pour bénéficier d’un habitat en adéquation avec son handicap, ne saurait être indemnisé sans tenir compte des sommes que la victime aurait de toute façon dû débourser pour se loger, si elle n’avait pas subi de handicap ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l’article 1382 du code civil et l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’appartement loué par Mme X… après l’accident, afin d’être indépendante et de ne plus habiter chez ses parents qui l’avaient hébergée jusque-là, n’était pas adapté au handicap causé par celui-ci ; que cet handicap avait rendu nécessaires des aménagements incompatibles avec le caractère provisoire d’une location ; que les conséquences dommageables de l’accident l’avaient contrainte à acquérir un terrain et à y faire construire une maison comportant des aménagements motivés par ses séquelles physiques ; que les factures concernant la maison étaient toutes justifiées par le handicap de Mme X… ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, la cour d’appel a pu déduire que les frais d’acquisition et d’aménagements de la maison exposés par la victime étaient en relation directe avec l’accident et devaient être pris en charge en totalité par M. Y…, indépendamment de l’économie réalisée par le non-paiement d’un loyer et de la réalisation d’un placement immobilier ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 421-1 III et R. 421-1 du code des assurances ;
Attendu, selon ces textes, que le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation ; qu’en raison du caractère subsidiaire de cette mission le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer ;
Attendu que l’arrêt met les dépens d’appel à la charge du FGAO ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant mis les dépens d’appel à la charge du FGAO, l’arrêt rendu le 11 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Met les dépens d’appel à la charge de M. Y… ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par confirmation du jugement entrepris, alloué à Mme X… la somme de 335 786, 01 euros au titre des frais de logement adapté ;
Aux motifs propres que « l’auteur responsable d’une infraction est tenu de réparer intégralement les conséquences du dommage qu’il a causé à la victime, incluant les frais d’aménagement d’un logement adapté au handicap de la victime ; que les frais de logement adapté incluent non seulement l’aménagement du domicile mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap ; que le principe de l’acquisition d’un logement est admis à condition qu’il existe un lien de causalité entre cette acquisition et l’accident ; que même en l’absence d’accident la victime aurait été dans l’obligation de se 1oger et elle est en droit de choisir son lieu de vie ; qu’en l’espèce Mademoiselle Virginie X… reste atteinte d’une tétraplégie sensitivo-motrice qui l’oblige à se déplacer en fauteuil roulant et la Cour d’appel, dans son arrêt en date du 6 juin 2005 a condamné Monsieur David Y… à réparer intégralement son préjudice et a réservé le poste d’aménagement du logement de la victime, qui âgée de seulement 18 ans demeurait encore chez ses parents ; qu’il résulte des débats que Virginie X…, lorsqu’elle a souhaité vivre de façon indépendante, a loué un appartement qui n’était pas adapté à son handicap car il était situé au premier étage d’un immeuble sans ascenseur ne comportant aucun aménagement spécifique ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir voulu faire l’acquisition d’un terrain pour y faire construire une maison aménagée à son handicap alors que l’aménagement d’un appartement en location est soumis au bon vouloir du propriétaire et qu’il n’existe, nonobstant la législation, que très peu de logements aménagés sur te marché ; que les aménagements ne correspondraient pas nécessairement aux besoins spécifiques de Mademoiselle X… et qu’il s’agit d’un mode de logement précaire ; qu’il convient de faire droit à la demande de Virginie X… d’acquisition d’un terrain et de construction d’une maison, ce qui permet de lui assurer un logement pérenne avec un aménagement adapté à son handicap, cette demande étant en lien direct avec les conséquences dommageables de l’accident ; que Mademoiselle Virginie X… verse aux débats l’intégralité des factures concernant la maison qu’elle a fait construire et il n’y a pas lieu de recourir à une mesure d’expertise, la cour étant suffisamment informée sur l’importance et la nature des travaux ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime est, comme l’a justement souligné le premier juge, indépendant de l’économie réalisée par le non-paiement d’un loyer et de la réalisation d’un placement immobilier » (arrêt attaqué, p. 4, § 6 à p. 5, § 4) ;
Et aux motifs réputés adoptés du premier juge que « l’indemnisation de la victime d’un fait dommageable repose sur le principe de la réparation intégrale des dommages causés ; que l’auteur d’un délit ou d’un quasi-délit est donc tenu à la réparation intégrale du dommage incluant les frais d’aménagement d’un logement adapté au handicap de la victime ; que cet aménagement du logement doit s’entendre de la mise en oeuvre des moyens permettant à la victime de se loger de manière adaptée en ce compris, le cas échéant, l’acquisition d’un bien immobilier ; que la prise en charge du coût de ces aménagements par le responsable est subordonnée à l’existence d’un lien de causalité direct avec le handicap de la victime ; que cette dernière doit ainsi démontrer que l’acquisition ou la construction d’un logement adapté a été rendu nécessaire du fait de son handicap, conséquence d’un fait dommageable ; qu’en l’espèce, ces principes doivent permettre à Mademoiselle Virginie X…, atteinte d’une tétraplégie sensitivo-motrice l’obligeant à se déplacer exclusivement en fauteuil roulant, de retrouver une autonomie comparable à celle dont elle bénéficiait antérieurement à l’accident ; que la Cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 6 juin 2005, a reconnu Monsieur David Y… civilement responsable et l’a condamné à réparer intégralement le préjudice subi par la demanderesse, en ce compris les aménagements nécessaires de son logement ; que cette décision a réservé les droits de la victime sur ce poste de préjudice en raison de sa situation personnelle au moment où elle a statué : Mademoiselle Virginie X… a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était âgée de 18 ans et qu’elle était encore hébergée chez ses parents ; qu’il ressort des attestations produites par la demanderesse, notamment celles de Messieurs Frédéric Z…, Raymond A… et Olivier B…, qu’antérieurement à l’acquisition de son logement actuel, elle résidait dans un appartement non adapté à son lourd handicap puisque situé notamment au premier étage d’un immeuble sans ascenseur ; que ce logement était également occupé en vertu d’un contrat de location ; qu’il ne saurait dès lors lui être reproché d’avoir souhaité acquérir un terrain sur lequel elle a fait construire un immeuble aménagé à son handicap alors que l’aménagement d’un immeuble en location est soumis au bon vouloir du propriétaire, doit être renouvelé à chaque changement de résidence et est, de ce fait, précaire ; qu’il résulte de ce qui précède que l’usage d’un fauteuil roulant et l’impossibilité d’aménager de façon pérenne le logement loué ont rendu nécessaires le changement de domicile, l’acquisition et la construction par Mademoiselle Virginie X… de son logement actuel ; qu’il convient en conséquence d’accueillir la demande d’indemnisation formée par Mademoiselle Virginie X… au titre de l’acquisition et la construction de son immeuble adapté à son handicap ; que le juge peut ordonner une expertise, lorsque des éclaircissements lui sont nécessaires pour trancher un litige ; qu’en l’espèce, vu les pièces versées aux débats par Mademoiselle Virginie X…, le Tribunal dispose de tous les éléments nécessaires à l’évaluation du préjudice qu’elle a subi ; que par conséquent, il convient de rejeter la demande d’expertise formulée par le fonds de garantie ; qu’en outre, le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime est indépendant à la fois de l’économie réalisée par le non-paiement d’un loyer et de la réalisation d’un placement immobilier ; que par ailleurs, l’indemnisation du préjudice économique ou de la perte de revenus est également distincte de celle liée à l’aménagement du logement ; que cette indemnisation vise uniquement à compenser la perte subie par la victime en raison de son préjudice ; qu’elle ne peut donc être minorée en raison des considérations sus mentionnées ; que la prise en charge du coût de l’acquisition et de l’aménagement du logement doit donc entièrement peser sur le responsable ; qu’en l’espèce, la seule contestation du fonds de garantie porte sur le principe de l’entière indemnisation et non sur le montant ni l’étendue des travaux réalisés rendus nécessaires au regard du handicap de la demanderesse ; qu’or, le principe de l’indemnisation du logement adapté est acquis à Mademoiselle Virginie X… ; qu’en outre, ni la construction de l’immeuble de la demanderesse rendue nécessaire du fait de son handicap, ni le fait que la victime ne paye plus de loyers à vie du fait de son accession à la propriété ne sauraient justifier une diminution de cette indemnisation ; qu’il ressort de l’acte d’acquisition du terrain et des diverses factures produites que le montant de l’indemnisation se décompose comme suit :
-67 000 euros au titre de l’acquisition du terrain,
-71 456, 25 euros au titre de la construction du logement adapté au handicap de la blessée,
-86 019, 50 euros au titre des aménagements extérieurs,
– et 111 310, 26 euros au titre des aménagements intérieurs,
soit une somme totale de 335 786, 01 euros ; qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur David Y…, reconnu civilement responsable par la Cour d’appel de TOULOUSE dans son arrêt du 6 juin 2005, à indemniser le préjudice subi par Mademoiselle Virginie X… à hauteur de ce montant ; que le présent jugement sera déclaré opposable au fonds de garantie » (jugement entrepris, p. 6, § 4 à p. 8, § 7) ;
Alors que l’indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que le préjudice lié aux frais de logement adapté, correspondant aux dépenses que la victime handicapée doit exposer pour bénéficier d’un habitat en adéquation avec son handicap, ne saurait être indemnisé sans tenir compte des sommes que la victime aurait de toute façon dû débourser pour se loger, si elle n’avait pas subi de handicap ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l’article 1382 du code civil et l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens d’appel ;
Alors que seules peuvent être prises en charge par le FGAO les indemnités dues aux victimes d’accidents de la circulation ; que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le FGAO peut être tenu d’assurer ; qu’en condamnant le Fonds de garantie aux dépens d’appel, la cour d’appel a violé les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances.
ECLI:FR:CCASS:2015:C200176
Analyse
Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse , du 11 février 2014
Source : Légifrance