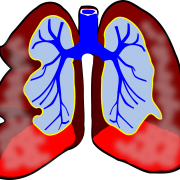Monsieur MOOR, citoyen suisse, avait été exposé à l’amiante de nombreuses années à compter de 1995 avant de décéder d’un cancer dû à ce produit. Il décéda en 2005 après avoir été indemnisé par la Caisse d’assurance maladie et après avoir lancé une action contre son employeur.
Sa veuve fit une demande d’indemnisation en tant que victime par ricochet la même année auprès de la Caisse d’assurance maladie suisse et les filles de M. MOOR continuèrent l’action engagée contre l’employeur.
Les deux affaires arrivèrent devant le Tribunal fédéral. Il jugea l’action de la veuve prescrite au motif que la loi impose un délai de dix ans à compter de l’acte qui a entraîné le dommage. Comme il était démontré que M. MOOR n’avait plus été exposé depuis 1995, l’action était prescrite en 2005. Pour l’action des filles de M. MOOR contre l’employeur, le Tribunal fédéral se basa sur la jurisprudence qui fait courir les créances de réparation à l’existence du fait dommageable et non sa connaissance. Or l’exposition à l’amiante était bien 10 ans.
Pour la CEDH, prescription et péremption constituent des limites au droit d’accès à un tribunal.
La limitation est possible si elle est légitime et proportionnelle au but visé mais elle ne doit pas rendre impossible le droit d’accéder au tribunal : délais trop court ou personne incapable de pouvoir agir ou action prescrite avant que la personne ait eu connaissance du fait et donc de son droit d’agir comme c’est le cas pour les maladies comme l’amiante où la maladie peut se révéler bien après l’exposition.
Il s’agit donc de faire une distinction entre les délais où le point de départ était connu du titulaire de l’action et les délais où le point de départ est inconnu du titulaire.
De même en cas de délai anormalement court, la question pourrait se poser au regard de cet arrêt. C’est le sentiment de certain concernant le délai de 3 ans dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux qui court à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage.
En l’affaire Howald Moor et autres c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 février 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
[spoiler title=”Lire la suite”]
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 52067/10 et 41072/11) dirigées contre la Confédération suisse et dont trois ressortissantes de cet État (« les requérantes »), Mme Renate Anita Howald Moor (« la première requérante »), et Mmes Caroline Moor et Monika Moor (« les deuxième et troisième requérantes »), ont saisi la Cour respectivement le 4 août 2010 et le 10 juin 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes ont été représentées par Me D. Husmann, avocat à Zürich. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Frank Schürmann, de l’Office fédéral de la justice.
3. Invoquant notamment l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent d’une violation du droit d’accès à un tribunal en raison de la péremption de leurs prétentions (quant à la première requérante) et de la prescription de leurs prétentions (quant aux deuxième et troisième requérantes) alors que, selon elles, le dies a quo du délai absolu avait commencé à courir avant qu’elles aient pu avoir objectivement connaissance de leurs droits.
4. Les requêtes ont été attribuées à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 7 décembre 2011, celle-ci a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La première requérante est née en 1949 et réside à Untersiggenthal. Elle avait épousé Hans Moor le 12 mai 2004. Les deuxième et troisième requérantes sont nées respectivement en 1973 et 1976 du premier mariage de Hans Moor, qui avait divorcé de sa première épouse le 9 janvier 1996, et elles résident à Zürich.
6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.
A. L’origine de la présente affaire
7. Né en 1946, Hans Moor acheva en 1964 un apprentissage de mécanicien-ajusteur dans la fabrique de machines Oerlikon (aujourd’hui Alstom SA). Il y resta employé jusqu’à son décès, survenu le 10 novembre 2005.
8. A partir de 1965, il y travailla en qualité de monteur sur turbines et y fut également chargé de travaux de révision des machines aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. Alors qu’il ignorait les risques liés à la poussière d’amiante, il fut exposé à cette matière au cours de ses différentes activités au moins jusqu’en 1978, date à laquelle il se vit offrir un poste de direction dans le service interne de l’entreprise.
9. Entre 1975 et 1976, la technique de flocage de l’amiante (Spritzasbest) fut interdite. Depuis 1989, l’amiante fait en Suisse l’objet d’une interdiction générale.
10. Hans Moor a affirmé avoir encore été en contact avec de l’amiante à l’occasion de deux voyages à l’étranger, l’un aux États-Unis, en 1992, et l’autre aux Antilles, en 1996.
11. En mai 2004, Hans Moor apprit qu’il souffrait d’un mésothéliome pleural malin causé par l’amiante à laquelle il avait été exposé dans le cadre de son travail.
12. Cette maladie professionnelle étant assimilée dans la loi fédérale sur l’assurance-accidents à un accident professionnel, la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (« la CNA ») versa à la victime, et ce jusqu’à son décès, les prestations prévues par la loi mentionnée, comprenant notamment la prise en charge des frais médicaux, des thérapies et des frais funéraires (15 931,55 francs suisses (CHF), soit environ 13 016 euros (EUR)), les indemnités journalières du 2 mai 2004 au 30 novembre 2005 (126 953,40 CHF, soit environ 102 901 EUR) et une rente d’invalidité à taux plein de 2 150 CHF (soit environ 1 743 EUR) par mois à compter du 1er avril 2005. De plus, comme il s’agissait d’une maladie professionnelle causée par l’amiante, ladite caisse versa une indemnité pour « atteinte à l’intégrité », qui s’élevait en l’espèce à 80 % du salaire annuel de l’assuré, soit 85 440 CHF (environ 69 253 EUR), dont la moitié fut versée à Hans Moor en 2005.
13. Le 25 octobre 2005, Hans Moor s’adressa au tribunal d’arrondissement de Baden pour obtenir de son employeur, Alstom SA, qui avait repris la fabrique entre-temps, le paiement de 200 579 CHF (soit environ 162 578 EUR) pour dommages-intérêts (préjudice ménager et prestation pour soins [Pflegeschaden]) et pour préjudice moral, plus les intérêts. Il argüait que la maladie dont il était atteint avait été provoquée par son exposition à l’amiante sur son lieu de travail. Il estimait que son employeur avait failli à ses obligations en omettant, en toute connaissance de cause selon lui, de prendre des mesures de sécurité pour les employés qui, comme lui-même, étaient régulièrement exposés à l’amiante.
14. Hans Moor décéda le 10 novembre 2005, à l’âge de 58 ans, des suites de sa maladie.
15. Depuis le 1er décembre 2005, la CNA verse à la première requérante, au titre de l’assurance-accidents, une rente à vie de veuve d’un montant mensuel de 3 253 CHF (soit environ 2 637 EUR), qui a été revalorisée à 3 448,55 CHF (soit environ 2 796 EUR) au 1er janvier 2009. De plus, la première requérante reçoit, depuis le 1er décembre 2005, en raison du décès de son époux pour cause de maladie professionnelle, une rente de veuve à taux plein de 1 720 CHF (soit environ 1 394 EUR) en vertu de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Enfin, elle touche des prestations de la caisse de compensation de l’employeur de Hans Moor, soit une rente temporaire de veuve qui lui sera versée jusqu’à la date à laquelle Hans Moor aurait eu 65 ans, puis elle percevra, conformément à son choix, une somme sous forme de capital.
16. En 2006, la seconde moitié de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité fut versée aux héritiers de Hans Moor (paragraphe 12 ci-dessus).
B. Les procédures intentées par la première requérante au niveau interne
1. Les procédures devant la CNA et le tribunal cantonal des assurances du canton d’Argovie
17. Le 14 novembre 2005, la première requérante adressa à la CNA une demande en réparation du dommage moral à hauteur de 50 000 CHF (soit environ 40 527 EUR). Elle soutenait que l’assurance était solidairement responsable avec l’employeur du décès de son époux. Elle estimait en effet que la CNA avait failli à ses obligations relatives à la sécurité au travail en ayant, d’une part, fourni des informations tardives et inadéquates sur les dangers liés à l’amiante et, d’autre part, omis de prendre les mesures de protection adéquates, de vérifier la nécessité de l’utilisation de l’amiante et de procéder à des examens préventifs. Par une lettre du 6 octobre 2006, les deuxième et troisième requérantes complétèrent cette requête par des demandes en réparation du dommage moral qu’elles estimaient avoir subi, ainsi que par des revendications portant sur la réparation d’un préjudice ménager, sur le paiement d’indemnités pour perte de soutien et sur le paiement des frais d’avocat.
18. Dans une décision du 16 octobre 2007, la CNA rejeta les demandes en dommages-intérêts au motif qu’elle ne pouvait être jugée responsable du décès de Hans Moor. Elle indiqua que, en tout état de cause, il y avait péremption pour les prétentions formulées relativement à des faits antérieurs à 1995, au sens de l’article 20, alinéa 1, de la loi fédérale sur la responsabilité (LRCF – paragraphe 44 ci-dessous) combinée avec l’article 78, alinéas 1 et 4, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA – paragraphe 43 ci-dessous) et avec l’article 20, alinéa 1, de la LRCF prévoyant pour la responsabilité un délai absolu de péremption de dix ans à compter de l’acte dommageable. En effet, la CNA retint l’année 1978 comme date du dernier acte dommageable, car aucun des moyens de preuve présentés n’était, selon elle, en mesure de corroborer la réalité d’une exposition à l’amiante lors des séjours ultérieurs de Hans Moor aux États-Unis et aux Antilles. Elle considéra ainsi que le délai était arrivé à échéance depuis 1988. Pour les prétentions qui n’étaient pas périmées, la CNA conclut à l’absence de preuves d’une quelconque exposition de Hans Moor à l’amiante après 1995.
19. Les intéressées formèrent un recours contre cette décision devant le tribunal cantonal des assurances du canton d’Argovie. Au cours de la procédure, les deuxième et troisième requérantes retirèrent leur demande de dommages-intérêts.
20. Dans une décision du 8 avril 2009, le tribunal cantonal débouta la première requérante de sa demande, confirmant la péremption pour les prétentions formulées pour les faits antérieurs à 1995 et l’absence de preuves pour celles relatives aux allégations d’exposition à l’amiante après 1995.
2. L’arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2010 (ATF 136 II 187)
21. La première requérante introduisit un recours de droit public contre cette décision devant le Tribunal fédéral, la plus haute juridiction suisse.
22. Dans un arrêt du 29 janvier 2010, notifié à la requérante le 5 février 2010, le Tribunal fédéral conclut à la péremption pour les prétentions de la requérante au motif que le délai absolu de dix ans courant à partir de la date de l’acte dommageable était échu, quand bien même le délai d’un an à compter de la date de la connaissance du dommage aurait été respecté.
23. Le Tribunal fédéral considéra le délai de l’article 20, alinéa 1, de la LRCF comme un délai de péremption et non de prescription[1]. Tout en reconnaissant la possibilité de restituer le délai de péremption dans certaines circonstances, par exemple lorsque l’ayant droit a été empêché de faire valoir ses prétentions pour des raisons insurmontables, indépendantes de sa volonté, telles que celles liées à la maladie, aux accidents ou aux catastrophes naturelles, il estima qu’il ne se justifiait pas de le faire en l’espèce. Il indiqua que la requérante ne pouvait se prévaloir de l’absence de connaissance du dommage pour demander une restitution de délai, car l’acceptation d’une telle justification aurait contredit le but du délai absolu de péremption.
24. Le Tribunal fédéral jugea par ailleurs que, en dépit des allégations de la requérante, les prétentions en responsabilité pouvaient en l’espèce s’éteindre au sens de l’article 20, alinéa 1, de la LRCF indépendamment du fait de savoir si le dommage s’était déjà produit. Il parvint à cette conclusion après avoir procédé à une interprétation textuelle et téléologique de cette disposition, suivie d’une comparaison entre la jurisprudence qui lui était consacrée et celle qui était développée relativement à des règles de prescription/péremption dans d’autres domaines du droit (paragraphe 46 ci‑dessous).
25. Il constata que, tant pour les prétentions en responsabilité fondées sur la LRCF que pour les prétentions tirées du droit pénal ou de la responsabilité civile, le délai de prescription/péremption commençait à courir à partir de la date de l’acte dommageable, et ce indépendamment de la date de l’apparition et de la réalisation du dommage. Il exposa que cela se justifiait par les impératifs de sécurité et de paix juridiques et par la difficulté accrue d’établir les faits et de collecter les preuves au fur et à mesure de l’écoulement du temps, et que, de plus, cela évitait qu’un créancier fasse valoir contre son débiteur des droits qu’il avait acquis à une époque trop lointaine.
26. Le Tribunal fédéral refusa en outre de voir en l’espèce une violation de l’article 6 de la Convention. Il nota que, pour des raisons de sécurité juridique, tous les États européens limitaient dans le temps la possibilité de faire valoir des prétentions civiles. Il précisa que cette limitation ne pouvait être considérée en l’espèce comme une atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal et, partant, qu’elle ne pouvait être considérée comme étant disproportionnée, au motif que le système suisse prévoyait pour les victimes de l’amiante et leurs proches survivants l’imprescripti-bilité des prestations de la CNA mentionnées ci-dessus et qu’il offrait un dédommagement adéquat.
27. Enfin, le Tribunal fédéral confirma l’appréciation des faits postérieurs à 1995 à laquelle avait procédé la juridiction inférieure et conclut à l’absence de preuves en ce qui concernait les prestations revendiquées pour la période postérieure à cette date.
C. Les procédures intentées par les deuxième et troisième requérantes au niveau interne
1. Devant le tribunal d’arrondissement de Baden et le tribunal cantonal du canton d’Argovie
28. Le 6 mai 2006, les deuxième et troisième requérantes, en tant qu’héritières de Hans Moor, déclarèrent vouloir poursuivre le procès intenté par leur défunt père à l’encontre de son employeur (paragraphe 13 ci‑dessus).
29. Dans une décision du 27 février 2009, le tribunal d’arrondissement de Baden rejeta les prétentions des requérantes. Après avoir constaté que les règles générales en matière de prescription s’appliquaient également aux obligations découlant du contrat de travail (article 341, alinéa 2, du code des obligations – paragraphe 51 ci-dessous), il conclut qu’il y avait prescription pour les prétentions nées de faits antérieurs à 1995 en s’appuyant sur les articles 127 et 130, alinéa 1, de la même loi (paragraphe 51 ci-dessous).
30. Il estima, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’article 130, alinéa 1, que le délai de prescription commençait à courir à la date du manquement à l’obligation découlant du contrat, indépendamment de la date à laquelle la partie lésée avait connaissance de son droit d’action. Pour le surplus, la juridiction de première instance estima qu’aucun des moyens de preuve présentés n’était de nature à corroborer la réalité d’une exposition à l’amiante lors du séjour, ultérieur, aux Antilles. Partant, elle conclut que les conditions requises pour l’engagement d’une éventuelle responsabilité de l’employeur n’étaient pas remplies en l’espèce.
31. Les requérantes formèrent un recours contre cette décision devant le tribunal cantonal.
32. Dans une décision du 2 mars 2010, le tribunal cantonal du canton d’Argovie débouta les requérantes, se fondant sur l’article 127 du code des obligations (paragraphe 51 ci-dessous) et confirmant que la prescription de dix ans devait être calculée à partir de la date de la violation de ses obligations par le débiteur et non pas à partir de la survenance du dommage. Ainsi, selon le tribunal cantonal, les manquements allégués de l’employeur à ses obligations avant le 25 octobre 1995 – y compris pendant la période allant de 1966 à 1978 pendant laquelle Hans Moor aurait été exposé à l’amiante de manière régulière et intensive – étaient prescrits. S’agissant des faits postérieurs au 25 octobre 1995, le tribunal jugea que la preuve d’un manquement à une obligation n’avait pas été apportée.
2. L’arrêt du Tribunal fédéral du 16 novembre 2010 (ATF 137 III 16)
33. A la suite de la décision du tribunal cantonal du canton d’Argovie, les deuxième et troisième requérantes intentèrent un recours devant le Tribunal fédéral.
34. Dans un arrêt du 16 novembre 2010, notifié aux requérantes le 27 janvier 2011, le Tribunal fédéral conclut à la prescription des prétentions des requérantes au motif que le délai absolu de dix ans courant à partir de la date de l’acte dommageable était échu, quand bien même le délai d’un an à compter de la date de la connaissance du dommage aurait été respecté.
35. Se fondant sur les articles 127 et 130, alinéa 1, du code des obligations (paragraphe 51 ci-dessous), le Tribunal fédéral exposa que, sauf si la loi disposait autrement, toute prétention était prescrite au bout de dix ans, le délai commençant à courir dès l’exigibilité de la créance, indépendamment de la connaissance par le créancier des conséquences du dommage. Il ajouta que cette norme s’appliquait à des créances en dommages-intérêts découlant d’un litige relatif à un contrat de travail.
36. Dans son raisonnement, le Tribunal fédéral examina la question des atteintes à l’intégrité physique. Il conclut, en se fondant sur l’article 46, alinéa 2, du code des obligations (applicable par le renvoi des articles 99, alinéas 3, et 75 de la même loi – paragraphe 51 ci-dessous), que ce qui était décisif pour la naissance du droit pour le créancier d’exiger réparation était le moment où l’auteur du dommage avait, en violation de ses obligations, porté atteinte à l’intégrité physique de l’autre partie.
37. Le Tribunal fédéral estima que, même si une partie de la doctrine allait dans le sens de l’opinion des requérantes selon laquelle le délai de prescription ne commençait à courir qu’à compter de la connaissance du dommage, il n’y avait aucune raison de s’écarter de la jurisprudence élaborée jusqu’alors et de traiter différemment les demandes de dommages-intérêts relatifs à un contrat de travail et les demandes de dommages-intérêts relatifs à des actes délictuels.
38. Cependant, il admit que, pour certaines maladies, l’apparition du dommage dépendait, d’un point de vue scientifique, du moment où la maladie se déclarait et qu’il n’était pas possible de prévoir un dommage avec une certitude suffisante avant l’écoulement du délai de prescription. Il indiqua que, si le législateur avait tenu compte de cet inconvénient dans certains domaines (par exemple dans le domaine de la radioprotection – article 40 de la loi sur la radioprotection du 22 mars 1991 – paragraphe 52 ci-dessous), il avait opté non pas pour une réglementation générale, mais pour une approche sectorielle, et qu’il n’avait pas prévu de réglementation spécifique pour les dommages dus à l’amiante, raison pour laquelle le Tribunal fédéral considéra que le recours était mal fondé.
39. Par ailleurs, le Tribunal fédéral réaffirma qu’il n’y avait pas violation de la Convention lorsqu’un créancier, au moment où il prenait connaissance de sa créance, n’avait plus le moyen d’en réclamer l’exécution. Il estima que pareil problème pouvait surgir de la même façon pour tout créancier, sans discrimination, et que l’on ne devait pas imposer à un débiteur l’obligation de conserver indéfiniment la preuve de l’accomplissement d’un contrat d’une façon conforme à ses obligations. Partant, il conclut à l’absence de discrimination en l’espèce.
D. Développements ultérieurs
40. Déposée le 11 octobre 2007, la motion parlementaire 07.3763 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national demanda au Conseil fédéral « de réviser le droit de la responsabilité civile, afin que les délais de prescription soient prolongés pour qu’une action en dommages-intérêts puisse être introduite même si un dommage se produi[sai]t à long terme ».
41. Le 28 novembre 2007, le Conseil fédéral proposa d’accepter la motion dès lors que la « nécessité de réviser le droit de la responsabilité civile dans le sens voulu par l’auteur de la motion [était] ainsi établie, du moins en ce qui concernait les dommages causés aux personnes. »
42. Le 29 novembre 2013, le Conseil fédéral présenta son projet de loi (« Message relatif à la modification du code des obligations [Droit de la prescription] » – ci-après projet ou projet de révision), élaboré sous l’égide de l’Office fédéral de la justice. Prévoyant l’allongement des délais de prescription (notamment un délai de prescription absolu de trente ans pour les dommages corporels), le projet vise essentiellement à uniformiser les dispositions en matière de droit de la prescription et à supprimer les incertitudes juridiques (pour plus de détails, voir les paragraphes 54-57 ci‑dessous).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Concernant les prétentions de la première requérante découlant du droit fédéral public (requête no 52067/10)
1. Le droit fédéral
43. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS – Recueil systématique du droit fédéral – 830.1) sont libellées comme suit :
Article 78 – Responsabilité
« 1 Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel.
2 L’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation.
3 La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l’administration ordinaire de la Confédération est régie par l’art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [voir paragraphe 44 ci-dessous].
4 Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n’y a pas de procédure d’opposition. Les art. 3 (…), 20, al. 1 [et] 21 (…) de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [voir paragraphe 44 ci-dessous] sont applicables par analogie.
5 Les personnes agissant en tant qu’organes ou agents d’un assureur, d’un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal. »
Article 82 – Dispositions transitoires
« 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d’invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d’une faute de l’assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau (…), au plus tôt à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. (…) »
44. Les dispositions pertinentes de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité (LRCF) ; RS 170.32) sont libellées comme suit :
Article 3
« 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2 Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. (…) »
Article 6
« 1 Si le fonctionnaire a commis une faute, l’autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.
2 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. »
Article 19
« 1 Si un organe ou un employé d’une institution indépendante de l’administration ordinaire qui est chargée d’exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l’exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération :
a. l’institution répond envers le lésé, (…), du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l’institution n’est pas en mesure de réparer. (…) ;
b. les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l’institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. (…).
2 (…).
3 L’institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l’institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. »
Article 20
« 1 La responsabilité de la Confédération (art. 3 ss) s’éteint si le lésé n’introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale dans l’année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage, et en tout cas dans les dix ans à compter de l’acte dommageable du fonctionnaire.
2 La demande doit être adressée au Département fédéral des finances.
3 Si, (…), la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption. »
Article 21
« Le droit de recours de la Confédération contre le fonctionnaire se prescrit par un an à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération et en tout cas par dix ans à compter de l’acte dommageable du fonctionnaire. »
2. Le projet de révision du droit de la prescription
45. Comme décrit plus haut, le droit de la prescription est en cours de révision (paragraphes 40-42 ci-dessus). Les dispositions générales pro-posées par le législateur devraient s’appliquer à toutes les créances de droit privé, qu’elles découlent d’un contrat, d’un acte illicite ou d’un enrichissement illégitime. La modification du droit en vigueur prévoit également que l’article 20, alinéa 1, de la LRCF se lise comme suit : « L’action contre la Confédération (…) se prescrit conformément aux dispositions générales du code des obligations sur la prescription. » Il s’ensuit que, selon la LCFR, les dispositions générales du projet du Conseil fédéral devraient également s’appliquer aux actions contre la Confédération (pour plus d’informations sur le projet de révision, voir également les paragraphes 54-57 ci-dessous).
3. La jurisprudence du Tribunal fédéral
46. Dans un arrêt du 21 juin 1988 (publié au Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse, ATF 114 V 123, considérant 3.b), le Tribunal fédéral a reconnu que la restitution pour inobservation d’un délai était un principe général du droit qu’il se justifiait d’appliquer même pour un délai de péremption s’il existait une cause légitime pour celui qui s’en prévalait.
47. Dans la présente affaire (ATF 136 II 187 ; voir para-graphes 21‑27 ci‑dessus), pour comparer la jurisprudence relative aux règles de prescription/péremption dans les différents domaines du droit, le Tribunal fédéral s’est appuyé sur un arrêt en matière pénale du 11 août 2008 (ATF 134 IV 297, considérant 4), estimant que, conformément au libellé de la loi, c’est le moment où l’auteur a exercé son activité dangereuse et non celui auquel se produisent les effets de cette dernière qui détermine le point de départ de la prescription. Pour le Tribunal fédéral, il s’ensuit que des actes pénalement répréhensibles peuvent être atteints par la prescription avant qu’en surviennent les effets et que cette conséquence est conforme aux droits fondamentaux.
48. Le Tribunal fédéral a tiré des conclusions similaires concernant le point de départ de la prescription dans des arrêts du 21 janvier 2000 pour les règles de la LRCF et du 4 avril 2001 pour les règles de la responsabilité civile délictuelle, tous deux publiés au Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (ATF 126 II 145, considérant 2b, et ATF 127 III 257, considérant 2b/aa).
49. Le Tribunal fédéral a choisi une autre approche dans l’arrêt du 1er octobre 2008 (ATF 134 II 308, considérant 5) dans le domaine de l’aide aux victimes d’infractions, dans lequel le délai de péremption ne commence à courir qu’une fois que tous les éléments constitutifs de l’infraction, comprenant le dommage, sont réalisés. Dans cet arrêt, il a estimé que, à la différence des autres domaines du droit mentionné, dans ce domaine la législation visait justement la protection des victimes et que c’était le point de vue de celles-ci qui devait être adopté (paragraphe 63 ci-dessous).
50. Dans un arrêt du 18 octobre 2006 (ATF 133 V 14, considérant 6), le Tribunal fédéral a jugé que le délai de l’article 20, alinéa 1, de la LRCF auquel renvoie l’article 78, alinéa 4, LPGA est un délai de péremption, et non un délai de prescription. Ce dernier type de délai ne peut être interrompu, et la demande doit impérativement être déposée en temps utile.
B. Concernant les prétentions des deuxième et troisième requérantes découlant du droit fédéral privé (requête no 41072/11)
1. Le droit fédéral
51. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations ; « code des obligations » ou « CO » ; RS 220) sont libellées comme suit :
Article 46 – Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles
« 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.
2 S’il n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. »
Article 60 – Prescription
« 1 L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit.
2 Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile.
3 Si l’acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d’exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. »
Article 75 – Époque de l’exécution – Obligations sans terme
« A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’obligation peut être exécutée et l’exécution peut en être exigée immédiatement. »
Article 99 – Étendue de la réparation
« 1-2 (…)
3 Les règles relatives à la responsabilité dérivant d’actes illicites s’appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. »
Article 127 – Prescription – Délais
« Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement. »
Article 130 – Début de la prescription
« 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2 Si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. »
Article 341 – Impossibilité de renoncer et prescription
« 1 (…)
2 Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. »
52. La disposition pertinente de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP ; RS 814.50) est libellée comme suit :
Article 40 – Prescription des prétentions en matière de responsabilité civile
« Les prétentions en matière de dommages-intérêts et de réparation du tort moral pour des dégâts occasionnés par des rayonnements ionisants et ne relevant pas de la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire [RS 732.44], se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne civilement responsable et au plus par 30 ans à compter du moment où l’événement a cessé. »
53. La disposition pertinente de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA ; RS 221.229.1) est libellée comme suit :
Article 46 – Prescription et déchéance
« 1 Les créances qui dérivent du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d’où naît l’obligation. (…)
2 (…) »
2. Le projet de révision du droit de la prescription
54. Le projet du Conseil fédéral expose que, dans les cas de demandes en réparation, lorsque le dommage est différé ou qu’il est difficile à déterminer, il peut arriver que le délai absolu soit expiré avant même la survenance ou l’identification du dommage. De telles périodes de latence se présentent avant tout en matière de lésions corporelles et d’atteintes à la santé dues, par exemple, à l’amiante, à certains médicaments ou à des matières radioactives. C’est la raison pour laquelle sera introduit pour ce type de dommages un délai absolu de trente ans en cas de dommages corporels. Les dommages corporels peuvent découler de lésions corporelles ou de mort d’homme.
55. Selon le projet, le jour à compter duquel le délai absolu commence à courir (dies a quo) est déterminé de façon objective, contrairement au délai relatif. Pour les actions en réparation du dommage et du tort moral, le moment déterminant est le comportement ayant causé le fait dommageable. Lorsque le comportement dommageable ne s’épuise pas en un seul acte mais s’inscrit dans la durée, le délai de prescription absolu ne commence à courir qu’au moment où la continuité de l’acte est rompue. Il ne peut commencer à courir tant que le comportement dommageable dure.
56. Le projet prévoit également en cas de lésions corporelles un délai relatif de trois ans calculé à compter du moment où le créancier a eu connaissance de la créance et de l’auteur du dommage.
57. Enfin, en ce qui concerne le droit transitoire, le projet énonce que les nouvelles dispositions ne seront en aucun cas applicables lorsque le délai de prescription prévu par l’ancien droit est déjà écoulé.
3. La jurisprudence du Tribunal fédéral
58. Le 19 septembre 1961, le Tribunal fédéral a jugé que la prescription décennale prévue aux articles 127 et 130, alinéa 1, du CO, court dès que la créance est exigible, indépendamment de la connaissance par le créancier de l’existence de son droit (ATF 87 II 155, considérant 3).
59. L’arrêt ATF 87 II 155 a été repris dans un arrêt du 3 juin 1980 concernant une action en dommages-intérêts dirigée contre l’ex-employeur d’un travailleur exposé à des radiations ionisantes sur son lieu de travail. Le Tribunal fédéral a confirmé que la prescription décennale de l’article 127 du CO, comme celle de l’article 60, alinéa 1, du CO, courait indépendamment de la connaissance par le créancier de l’existence de son droit (ATF 106 II 134, considérant 2a).
60. Cette solution a été critiquée par une partie de la doctrine. Mais selon le Tribunal fédéral, la prescription de dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit est subsidiaire et vise à éviter, dans l’intérêt de la sécurité juridique, qu’un débiteur ne soit menacé par des réclamations au-delà d’un délai de plus longue durée dont le point de départ est fixé strictement, sans égard à la connaissance par le créancier du dommage et de son auteur (ATF 106 II 134 considérant 2c).
61. Cependant, le Tribunal fédéral admet que cette réglementation peut être trop stricte pour le lésé et il note à cet égard que le législateur a, dans certains cas, prévu des solutions spécifiques. Par exemple, pour résoudre le problème des effets tardifs des radiations ionisantes, le législateur a, dans la loi du 23 décembre 1959 sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et la protection contre les radiations, renvoyé le lésé vers un fonds pour dommages atomiques différés pour faire valoir ses prétentions en réparation de dommages corporels au-delà du délai de prescription absolu (article 18 LUA ; ATF 106 II 134, considérant 2c).
62. On rappellera cependant que cette disposition ne s’appliquait que dans le cas des radiations ionisantes. Par ailleurs, aujourd’hui la question serait réglée différemment, car, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la radioprotection (LRaP), le délai absolu de prescription concernant les prétentions de personnes lésées par des radiations ionisantes est de trente ans (article 40 ; paragraphe 52 ci-dessus).
63. Le 1er octobre 2008, le Tribunal fédéral a jugé que, dans le domaine de l’aide aux victimes d’infractions, le délai de prescription ne commençait à courir qu’une fois le dommage réalisé. Il a en effet estimé que, dans ce domaine, la législation visait justement la protection des victimes et que c’était le point de vue de celles-ci qui devait être adopté (ATF 134 II 308, considérant 5).
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
64. Considérant que les deux requêtes concernent la même question, à savoir le droit d’accès à un tribunal, la Cour décide de les joindre.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 6
65. Dans leurs requêtes, les requérantes se plaignent essentiellement d’une violation du droit d’accès à un tribunal. Elles invoquent également les articles 2, 8, 13 de la Convention et l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention.
66. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Halil Yüksel Akıncı c. Turquie, no 39125/04, § 54, 11 décembre 2012, Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, § 43, CEDH 2012, et Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I), estime approprié d’examiner la présente affaire sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 14 (combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention), dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…), qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…). »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A. Sur la recevabilité
67. Constatant que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
68. En résumé, les requérantes se plaignent d’une violation du droit d’accès à un tribunal, au motif que leurs prétentions ont été jugées périmées ou prescrites alors que, selon elles, les délais de péremption/prescription avaient commencé à courir avant qu’elles aient pu avoir objectivement connaissance de leurs droits. Partant, les requérantes, qui disent se référer à la jurisprudence de la Cour, sont d’avis que les limitations dénoncées ont restreint l’accès à un tribunal de manière ou à un point tels que leur droit à un tribunal en aurait été atteint dans sa substance même. Elles ajoutent qu’il n’existait aucune possibilité réelle de faire valoir des droits avant la péremption ou la prescription de ceux-ci.
69. Le Gouvernement rétorque qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention. En résumé, il soutient que les États contractants jouissent d’une marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de déterminer comment circonscrire le droit d’accès à un tribunal. Il indique que, dans la présente affaire, les requérantes ont pu porter leurs griefs devant plusieurs juridictions internes et que celles-ci les ont examinés à la lumière du droit interne applicable et de la Convention. Il en déduit qu’elles ont donc bien eu accès à un tribunal, même si l’examen par les juridictions internes s’est trouvé, pour des motifs légitimes selon lui, limité par la péremption ou la prescription des prétentions des intéressées. Enfin, il est d’avis que la Cour ne peut s’ériger en juridiction de quatrième instance.
2. L’appréciation par la Cour
a) Sur le grief tiré de l’article 6 § 1
i. Les principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
70. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils (voir, entre autres, Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 49, CEDH 2002‑IX, et Eşim c. Turquie, no 59601/09, § 18, 17 septembre 2013). Elle réaffirme que chaque justiciable a droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 de la Convention consacre le droit à un tribunal, dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect particulier (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18, et Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 43, CEDH 2001‑VIII).
71. La Cour rappelle ensuite sa jurisprudence selon laquelle le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000‑II). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sasubstance même (Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 230, CEDH 2012). La Cour rappelle en outre que les limitations appliquées ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, Pedro Ramos c. Suisse, no 10111/06, § 37, 14 octobre 2010, Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, § 40, Recueil 1996‑V, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, § 50, Recueil 1996‑IV, et Stagno c. Belgique, no 1062/07, § 25, 7 juillet 2009).
72. Parmi ces restrictions légitimes figurent les délais légaux de péremption ou de prescription qui, la Cour le rappelle, dans les affaires d’atteinte à l’intégrité de la personne, ont plusieurs finalités importantes, à savoir garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (Stubbings, précité, § 51, et Stagno, précité, § 26 ).
73. Enfin, la Cour renvoie à l’arrêt Eşim (précité). Dans cette affaire, le requérant avait été blessé en 1990 lors d’un conflit militaire et les médecins n’avaient découvert la balle de pistolet logée dans sa tête qu’en 2007. Les tribunaux internes avaient jugé que la prétention ainsi que l’action en dommages-intérêts étaient prescrites. La Cour a conclu à la violation du droit d’accès à un tribunal, estimant que, dans les affaires d’indemnisation des victimes d’atteinte à l’intégrité physique, celles-ci devaient avoir le droit d’agir en justice lorsqu’elles étaient effectivement en mesure d’évaluer le dommage subi.
ii. L’application des principes susmentionnés à la présente affaire
74. En l’espèce, la Cour note d’emblée que le présent litige porte sur un problème complexe, à savoir la fixation du dies a quo du délai de péremption ou de prescription décennale en droit positif suisse dans le cas des victimes d’exposition à l’amiante. Considérant que la période de latence des maladies liées à l’exposition à l’amiante peut s’étendre sur plusieurs décennies, elle observe que le délai absolu de dix ans – qui selon la législation en vigueur et la jurisprudence du Tribunal fédéral commence à courir à la date à laquelle l’intéressé a été exposé à la poussière d’amiante – sera toujours expiré. Par conséquent, toute action en dommages-intérêts sera a priori vouée à l’échec, étant périmée ou prescrite avant même que les victimes de l’amiante aient pu avoir objectivement connaissance de leurs droits.
75. Ensuite, la Cour constate que les prétentions des victimes de l’amiante, qui ont été exposées à cette substance jusqu’à son interdiction générale en Suisse, en 1989, sont toutes périmées ou prescrites au regard du droit en vigueur. Elle observe également que le projet de révision du droit de la prescription suisse ne prévoit aucune solution équitable – ne serait-ce qu’à titre transitoire, sous la forme d’un « délai de grâce » – au problème posé.
76. Par ailleurs, la Cour ne méconnaît pas que les requérantes ont touché certaines prestations. Elle se demande cependant si celles-ci sont de nature à compenser entièrement les dommages résultés pour les intéressées de la péremption ou de la prescription de leurs droits.
77. Par ailleurs, même si elle est convaincue des buts légitimes poursuivis par les règles de péremption ou de prescription appliquées, à savoir notamment la sécurité juridique, la Cour s’interroge sur le caractère proportionné de leur application à la présente espèce. En effet, elle admet, comme le soutiennent les requérantes, que l’application systématique de ces règles à des victimes de maladies qui, comme celles causées par l’amiante, ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes, est susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice.
78. Prenant en compte la législation existant en Suisse pour des situations analogues et sans vouloir préjuger d’autres solutions envisageables, la Cour estime que, lorsqu’il est scientifiquement prouvé qu’une personne est dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffre d’une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription.
79. Partant, au vu des circonstances exceptionnelles de la présente espèce, la Cour estime que l’application des délais de péremption ou de prescription a limité l’accès à un tribunal à un point tel que le droit des requérantes s’en est trouvé atteint dans sa substance même, et qu’elle a ainsi emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Stagno, précité, § 33, avec les références qui y sont citées).
80. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
b) Sur le grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention
81. Eu égard à son constat figurant aux paragraphes 79 et 80 ci-dessus, la Cour estime qu’il ne s’impose pas d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
82. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
83. La première requérante réclame 288 755 francs suisses (CHF), soit environ 234 406 euros (EUR), et les deuxième et troisième requérantes 200 579 CHF (soit environ 162 826 EUR), sommes majorées d’intérêts de 5 % par année. Elles sollicitent ces montants pour le préjudice matériel qui aurait découlé de l’application du droit suisse de la péremption (s’agissant de la première requérante) et de la prescription (s’agissant des deuxième et troisième requérantes).
84. De plus, les requérantes demandent une compensation de 15 000 CHF conjointement (soit environ 12 180 EUR) pour le dommage moral qu’elles estiment être résulté de la durée du litige et de la souffrance psychologique née, selon elles, de l’incertitude quant à l’issue de la procédure.
85. Le Gouvernement conteste ces montants, soutenant que, dans la présente procédure, les seules questions litigieuses sont de savoir si les requérantes ont eu accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention, et si les deuxième et troisième requérantes ont été victimes d’une discrimination fondée sur la nature de la maladie du défunt, en violation de l’article 14 de la Convention combiné avec son article 6 § 1. Il est d’avis que l’objet de la présente requête n’est pas de déterminer si les prétentions que la première requérante a formulées à l’encontre de la CNA et que le défunt père des deuxième et troisième requérantes a présentées à l’encontre de son employeur, Alstom SA, sont légitimes au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. Il en déduit que le lien de causalité entre le constat de violation et le dommage matériel allégué fait manifestement défaut et que les prétentions des requérantes doivent être rejetées pour ce motif.
86. Quant à la réparation du tort moral, le Gouvernement soutient que les requérantes ne justifient nullement le montant présenté à ce titre. Il indique que, si la Cour concluait à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention ou encore (dans le cas des deuxième et troisième requérantes) de l’article 14 de la Convention, ce constat constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral dont les requérantes auraient pu souffrir.
87. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette la demande présentée à ce titre. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux requérantes 15 000 CHF (soit environ 12 180 EUR) au titre du préjudice moral, notamment à raison des souffrances psychologiques subies par les intéressées.
B. Frais et dépens
88. Les requérantes soutiennent que leur avocat a consacré à leur affaire 58,2 heures (pour la première requérante, dont 45,7 heures pour la rédaction de la requête du 4 août 2010) et 44,3 heures (pour les deuxième et troisième requérantes, dont 24,8 heures pour la rédaction de la requête du 10 juin 2011). Le taux horaire habituel d’un avocat zurichois s’élève à 300 CHF hors TVA (soit environ 244 EUR).
89. Le Gouvernement indique que la première requérante n’étaye pas ces prétentions. Il considère que, si l’on tient compte des écritures rédigées par le représentant devant la Cour et du fait que celle-ci a retenu un seul grief (parmi ceux formulés par la première requérante), l’octroi d’une indemnité de 3 000 CHF (soit environ 2 435 EUR) serait approprié pour couvrir les frais et dépens pour la procédure engagée devant la Cour. Quant aux deuxième et troisième requérantes, il est d’avis que les frais d’avocat n’ont pas été réellement et nécessairement engagés pour faire constater la violation alléguée. Il précise que les griefs soulevés par les deuxième et troisième requérantes n’ont que partiellement été pris en compte par la Cour. Partant, l’octroi d’une indemnité de 3 000 CHF (soit environ 2 435 EUR), lui semblerait approprié pour couvrir les frais et dépens pour la procédure engagée devant la Cour.
90. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
91. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, elle estime raisonnable la somme de 5 000 EUR (soit environ 6 165 CHF), tous frais confondus, et l’accorde à la première requérante, augmentée de tout montant pouvant être dû par l’intéressée à titre d’impôt.
92. En ce qui concerne les deuxième et troisième requérantes, la Cour, considérant notamment que leur requête repose partiellement sur celle de la première requérante, estime raisonnable la somme de 4 000 EUR (soit environ 4 932 CHF), tous frais confondus, et l’accorde conjointement aux deuxième et troisième requérantes, augmentée de tout montant pouvant être dû par les intéressées à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
93. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes ;
2. Déclare, à l’unanimité, les requêtes recevables ;
3. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner l’affaire sous l’angle l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit, par six voix contre une,
a) que l’État défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en francs suisses, au taux applicable à la date du règlement :
i. 12 180 EUR (douze mille cent quatre-vingts euros) conjointement à Mmes Renate Anita Howald Moor, Caroline Moor et Monika Moor, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros) à Mme Renate Anita Howald Moor, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante,
iii. 4 000 EUR (quatre mille euros) conjointement à Mmes Caroline Moor et Monika Moor, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 mars 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Guido Raimondi
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées des juges Lemmens et Spano.
G.R.A.
S.H.N.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE LEMMENS
1. À mon grand regret, je n’ai pu voter avec la majorité en ce qui concerne la question principale dans cette affaire, celle de savoir s’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Dans la présente affaire, deux délais de prescription ou de péremption étaient en cause. En ce qui concerne l’action de feu M. Moor, reprise par ses enfants et dirigée contre l’employeur de celui-ci, l’article 127 du code des obligations prévoyait un délai de prescription de dix ans, et l’article 130, alinéa 1, disposait que la prescription courait « dès que la créance est devenue exigible ». Selon le Tribunal fédéral, cette dernière disposition impliquait qu’il y avait un délai maximal de dix ans à compter de l’acte dommageable, indépendamment du moment où la partie lésée avait connaissance du dommage. En ce qui concerne l’action de la veuve de M. Moor, dirigée contre la caisse nationale d’assurance en cas d’accidents –une autorité publique – l’article 20, alinéa 1, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération prévoyait explicitement un délai de péremption d’un an à compter du jour où la partie lésée avait eu connaissance du dommage, avec toutefois un délai maximal de dix ans « à compter de l’acte dommageable ».
Le législateur suisse a donc limité le droit d’action, pour les deux types d’action, à un délai de dix ans à partir de l’acte dommageable. Selon la majorité, ce délai a limité le droit d’accès des requérantes à un tribunal à un point tel que ce droit a été violé. La majorité précise qu’elle arrive à cette conclusion « au vu des circonstances exceptionnelles de la présente espèce » (paragraphe 79 de l’arrêt).
3. À mon avis, les États parties à la Convention sont entièrement libres, sous réserve de leurs obligations positives découlant de la Convention, de déterminer l’étendue des droits subjectifs qu’ils créent dans leur ordre juridique. Cela implique qu’ils sont en principe libres de circonscrire le droit d’action (ou l’action) lié à un droit subjectif.
En l’espèce, le législateur suisse a estimé que, sauf exception prévue par la loi, le droit d’action s’éteint dix ans après le fait dommageable. Autrement dit, à partir de ce moment, il n’y a plus de droit d’action.
Je ne suis pas sûr que dans une telle situation l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription ou de péremption de l’action constitue une limitation du droit d’accès à un tribunal. Certes, la prescription ou la péremption empêche qu’un juge puisse encore se prononcer sur l’action. Mais c’est ce qu’a voulu le législateur quand il a créé le droit subjectif et l’a assorti – implicitement – d’un droit d’action. La majorité reconnaît par ailleurs que des délais de prescription ou de péremption peuvent poursuivre des finalités importantes (paragraphe 72 de l’arrêt).
Il peut y avoir un problème sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention si le délai de prescription ou de péremption, en ne tenant pas compte des circonstances particulières d’une affaire, empêche un justiciable d’exercer une action qui était en principe disponible pour lui (Stagno c. Belgique, no 1062/07, § 33, 7 juillet 2009). Tel ne me semble pas être le cas en l’espèce : au moment où M. Moor et son épouse ont introduit leurs demandes, leur droit d’action, comme celui de toute personne lésée dans la même situation, était déjà éteint. À aucun moment antérieur ils n’ont été en mesure d’exercer ce droit, faute de l’apparition d’effets dommageables des actes reprochés aux parties défenderesses.
L’arrêt suit la ligne de jurisprudence développée dans les affaires Sabri Güneş et Eşim. La Cour y a énoncé, d’une manière générale, qu’ « en matière d’indemnisation du dommage corporel, le droit de recours doit s’exercer à partir du moment où les justiciables peuvent effectivement évaluer le dommage qu’ils ont subi » (Sabri Güneş c. Turquie, no 27396/06, § 66, 24 mai 2011, et Eşim c. Turquie, no 59601/09, § 25, 17 septembre 2013). Dans la présente affaire, « la Cour estime que, lorsqu’il est scientifiquement prouvé qu’une personne est dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffre d’une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription » (paragraphe 78 de l’arrêt). À mon avis, la Cour empiète ainsi sur le domaine des autorités nationales. Je fais observer que l’affaire Sabri Güneş a été déférée à la Grande Chambre. Toutefois, la Grande Chambre a constaté que la requête avait été introduite plus de six mois après la signification de la décision interne définitive, de sorte qu’elle n’a pas pu se pencher sur la question de la limitation du droit d’accès à un tribunal (Sabri Güneş c. Turquie [GC], no 27396/06, 29 juin 2012).
4. Les circonstances particulières de l’affaire sont pertinentes pour évaluer l’effet de l’application des règles de prescription et de péremption.
C’est un fait que les requérantes n’ont pas pu introduire ou poursuivre une demande recevable. Toutefois, selon les données du dossier, M. Moor aurait été exposé à l’amiante « au moins jusqu’en 1978 » (paragraphe 8), et l’amiante a été interdite en Suisse à partir de 1989 (paragraphe 9). On peut donc retenir l’année 1978 ou, du moins, l’année 1989 comme la date du dernier acte dommageable. Or les actions en justice ont été intentées respectivement en 2005 et en 2006, c’est-à-dire 27 et 28 ans, ou du moins 16 et 17 ans, après les faits. Ce sont des délais considérables, qui rendent difficile de conclure qu’il y a eu une limitation « disproportionnée » du droit d’accès à un tribunal.
5. Le fait de prévoir des délais de prescription courts peut soulever un problème sous l’angle d’autres dispositions de la Convention. C’est ainsi que, dans des affaires de droit de la famille, la Cour a constaté quelquefois qu’en rendant impossible l’introduction de demandes d’un certain type par l’application rigide des règles de prescription, l’État défendeur avait méconnu son obligation positive de protéger le droit au respect de la vie privée des intéressés (Shofman c. Russie, no 74826/01, 24 novembre 2005, etPhinikaridou c. Chypre, no 23890/02, 20 décembre 2007).
En l’espèce, les requérantes n’invoquaient pas un tel grief, et il me semble difficile de concevoir une incompatibilité avec d’autres dispositions de la Convention. De toute façon, si l’on considère la péremption ou la prescription comme une atteinte à un droit matériel garanti par la Convention, il faudrait alors prendre encore en considération le fait que les requérantes ont touché des prestations par le biais des assurances sociales.
6. Tout ce qui précède n’enlève rien au fait que, sur le plan de l’opportunité et même de l’équité, il y a de bons motifs pour le législateur de modifier les règles en vigueur. On peut paraphraser l’arrêt Stubbings et autres c. Royaume-Uni, et espérer que, « dans un proche avenir », le législateur examine la possibilité d’« amender les règles sur la prescription des actions (…) afin d’édicter des dispositions spéciales pour [le] groupe de plaignants [auquel les requérantes appartiennent] » (Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, § 56, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV).
OPINION CONCORDANTE DU JUGE SPANO
(Traduction)
1. Au paragraphe 78 de l’arrêt, la Cour dit, à juste titre, qu’au moment de fixer la durée du délai de prescription pour l’introduction d’une action en indemnisation, il faut tenir compte des cas où il est scientifiquement prouvé qu’il est impossible pour une personne souffrant d’une affection donnée d’avoir eu connaissance de sa maladie avant un certain délai.
2. La présente opinion a pour but d’expliquer la manière dont je comprends cette considération de l’arrêt rendu ce jour.
3. Les délais de prescription, qui répondent à l’intérêt public de garantir la sécurité juridique et le caractère définitif de l’administration de la justice (Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 2006, § 51), ont inévitablement pour effet d’exclure la résolution judiciaire de certains griefs qui peuvent être tout à fait justifiés quant au fond. Pour autant, on ne saurait interpréter le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 comme signifiant qu’en matière d’action civile en indemnisation, un délai de prescription absolu qui commence à courir à la date où l’acte a eu lieu et non à celle où le demandeur peut avoir connaissance de sa maladie sera toujours jugé disproportionné au regard de la Convention. Le critère à retenir doit être celui de savoir si la durée d’un délai absolu peut être considérée comme raisonnable à la lumière des éléments essentiels de la majorité des affaires auquel il s’applique (voir Stubbings et autres, précité, § 53 : « Le délai dont il s’agit n’était pas exagérément court ; … »).
4. Dès lors, si, en matière d’action civile en indemnisation dans les cas de maladies professionnelles à longue durée d’incubation, un État adopte un délai de prescription qui tient raisonnablement compte de la grande majorité des cas, l’application d’un tel délai peut, en principe, être conforme à l’article 6 § 1, même dans les cas où, n’ayant pas eu connaissance suffisamment tôt de sa maladie et du fait qu’elle était de cause professionnelle, le demandeur s’est trouvé dans l’impossibilité d’introduire son action avant l’expiration de ce délai. Le point de savoir si le régime interne offre d’autres possibilités d’obtenir réparation, par exemple par un fonds public d’indemnisation, est aussi un facteur à prendre en compte dans l’appréciation de la proportionnalité de la mesure au regard de l’article 6 § 1.
5. A la lumière de ces considérations, il m’apparaît que la conclusion à laquelle la Cour est parvenue sur ce point en l’espèce doit être comprise non pas comme excluant la possibilité que le droit interne puisse prévoir des délais de prescription absolus commençant à courir à la date de l’acte dans les procédures telles que celle en cause ici, mais comme exigeant que ces délais ne soient pas exagérément courts compte tenu de leur champ d’application général.
6. Appliquant ces principes aux faits de la cause, je suis d’accord avec la Cour pour dire que le délai absolu de dix ans appliqué en l’espèce a constitué une réponse disproportionnée, au sens de l’article 6 § 1, à la situation du requérant. En bref, ce délai ne tenait pas raisonnablement compte des éléments essentiels inhérents à la majorité des cas de maladie liée à l’amiante.
[1]. À la différence du délai de prescription, le délai de péremption ne peut être interrompu et doit être appliqué d’office par le juge.
http://hudoc.echr.coe.int/[/spoiler]







 Des 3 priorités de santé publique du programme 2008-2012 (soins palliatifs, Alzheimer, cancérologie), les soins palliatifs est l’axe qui a le moins réussi à combler ses retards et les inégalités.
Des 3 priorités de santé publique du programme 2008-2012 (soins palliatifs, Alzheimer, cancérologie), les soins palliatifs est l’axe qui a le moins réussi à combler ses retards et les inégalités.